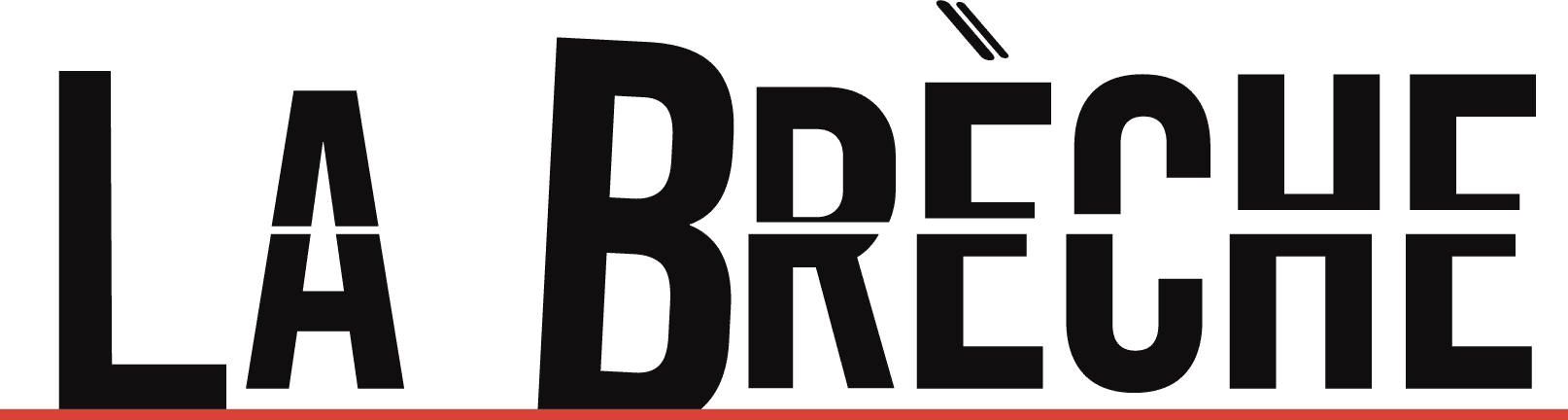Surveillance sanitaire : ces malformations que l’État ne veut pas voir
Le Remera (Registre des malformations en Rhône-Alpes), qui a permis de lancer l’alerte sur les scandales de la Dépakine et des bébés nés sans bras, ne couvre plus que quatre départements, contre seize jusqu’en 2003. Pire, il pourrait fermer ses portes. Après Marseille, Fos-sur-Mer, la Normandie avec La Hague, la Champagne et ses pesticides, Lyon viendrait s’ajouter à la longue liste des villes non couvertes par un tel registre. Autant de lieux qui dévoilent la volonté de l’État de ne pas assurer une surveillance sanitaire sur les maladies environnementales.
Tout est parti du scandale du thalidomide. Ce médicament, prescrit à partir de 1957 aux femmes enceintes pour combattre les nausées, a généré de graves malformations congénitales. Il a fallu attendre 1961 pour prouver les effets tératogènes (N.D.L.R. susceptibles de provoquer des malformations congénitales chez les enfants exposés in utero) du thalidomide et engendrer son interdiction. 10 000 à 20 000 cas sont répertoriés, principalement en Allemagne et en Grande-Bretagne. En France, ce médicament n’a pas été prescrit car l’administration a tardé dans son autorisation de mise sur le marché. Devant ce scandale, une évidence apparaît au professeur Robert, un généticien lyonnais : il faut compiler des données.
« Il se dit que si un nouveau tératogène arrive sur le marché, personne ne sera capable d’identifier une augmentation du nombre de cas et leur répartition », raconte Emmanuelle Amar, directrice du Remera depuis 2003. En 1973, il invente donc la notion de registre pour les naissances avec malformation : « Il coupe la France en quatre. Le registre couvre alors seize départements contre quatre aujourd’hui. » Ce premier registre français se nomme alors l’Institut européen des génomutations (IEG) et deviendra Remera en 2007.
« Pour éviter un scandale sanitaire, la référence est le registre »
« Un repérage précoce d’une anomalie dans la fréquence et la répartition des malformations va permettre d’émettre des hypothèses sur les causes possibles. Cela peut déboucher sur des études, qui intègrent des analyses de la qualité de l’eau, de l’air et les éventuelles causes possibles. Pour éviter un scandale sanitaire, la référence est le registre », souligne Emmanuelle Amar. Un tel registre a un rôle d’autant plus important que les malformations ne sont pas systématiquement notifiées à la naissance : « En France, nous avons un système de déclaration obligatoire pour 26 maladies, toutes transmissibles, à l’exception du saturnisme. Pour les cancers, problèmes cardiovasculaires et malformations, il n’existe pas de registre national. La maladie est vue comme un problème individuel et la pensée française n’est pas prête à l’envisager sous son aspect collectif et social. » L’environnement est très rarement pris en compte : « On le voit avec les messages de prévention pour les femmes enceintes, on a zéro alcool et zéro tabac, point final. Pas grand-chose sur les médicaments et rien sur les cosmétiques, produits ménagers, phytosanitaires, etc. » Pourtant le Remera a déjà prouvé l’importance d’une vigilance sur cette question.
Scandale de la Depakine : 33 ans de perdus et 14 000 victimes
Élisabeth Robert-Gnansia prend le relais à la tête de l’IEG en 1982. Elle repère des points communs chez les mères d’enfants porteurs de spina-bifida, un défaut de fermeture de la colonne vertébrale qui engendre des troubles neurologiques, tels qu’une paralysie des membres inférieurs : « Elle découvre qu’un médicament pris par les mères, la Depakine, augmente de 30 % les risques de malformation, c’est énorme. Elle publie dès 1982 un article dans le Lancet pour démontrer que la Depakine est tératogène. » Son alerte restera d’abord sans écho : « La Depakine est un médicament prescrit contre l’épilepsie. Il n’est pas si simple de le suppléer mais on sait maintenant que d’autres solutions existaient. Mais la Depakine est fabriquée en France, à Grenoble. C’est peut-être lié ou pas… » Toujours est-il que pendant des années, rien ne bouge, si ce n’est qu’on réalise une échographie pour toutes les grossesses sous Depakine afin de repérer toute anomalie chez les fœtus exposés à ce médicament, en se disant qu’une interruption de grossesse sera possible. Au début des années 2000, grâce aux réseaux sociaux, des alertes sont lancées : la Depakine augmente aussi le risque de troubles du développement et autistiques. Cela ne se repère pas à l’échographie : « Le scandale de la Depakine explose en 2015. » 33 ans de perdus et plus de 14 000 vies brisées.
En France, seulement 20 % des grossesses surveillées
Emmanuelle Amar est recrutée en 2003 au sein du registre IEG, alors financé par l’Institut de veille sanitaire, l’Inserm, des laboratoires pharmaceutiques et la MSA (Mutualité sociale agricole). Trois ans plus tard, le registre propose de participer à une étude sur les relations entre les pesticides et les malformations. La MSA décide alors d’arrêter son financement prétextant un conflit d’intérêts. « On se dit, “ce n’est pas possible”. 60 000 dossiers risquaient de partir à la benne. Nous les avons sauvés en créant le Remera, dès le 1er janvier 2007, mais en réduisant sa couverture, faute de moyens financiers, à quatre départements (Loire, Isère, Rhône et Ain). » Le budget annuel ne semble pourtant pas démesuré : 200 000 euros pour une efficacité démontrée.
La directrice du Remera dénonce « le refus » des autorités de mettre en place un registre national : « S’il n’y en a pas, c’est que l’on ne veut pas. » Des tests sont effectués sur 99,9 % des bébés qui naissent en France afin de repérer une maladie grave : « En 2017, on a proposé d’ajouter une simple ligne pour les malformations. » Un moyen simple et économique de compiler ces données : « Les professionnels de santé étaient partants, mais il y a eu un refus de la part des autorités. »
Actuellement, la France compte sept registres qui couvrent la ville de Paris, la Bretagne, l’Auvergne, les départements surveillés par le Remera, les Antilles, La Réunion et dernièrement Bordeaux : « En part de la population, ça ne couvre qu’environ 20 % des grossesses. On connaît le nombre de voitures en circulation, mais pas le nombre d’enfants nés avec une malformation. On priorise les biens sur la santé », peste Emmanuelle Amar.
Depuis 1973, les moyens de surveillance ont baissé. Une aberration aux yeux de la directrice du Remera : « La surveillance de toutes les malformations pour la France entière coûterait 3,5 millions d’euros et c’est refusé. C’est le coût d’un mois de cabinet-conseil… »
Scandale des bébés sans bras : « On a commencé à surveiller l’Ain et là on a vu »
Le Remera a également permis d’alerter sur le scandale des bébés nés sans bras1. Fin 2010, le registre reçoit un premier signalement de plusieurs cas de naissances avec une agénésie transverse des membres supérieurs (ATMS)2, de la part d’un médecin de l’Ain. « Nous n’avions aucune information, puisqu’on ne surveillait pas ce département. Quand on informe Santé publique France que l’on voudrait surveiller l’Ain, c’est un refus catégorique. On propose d’échanger la surveillance de la Savoie, où il n’y avait rien de particulier, pour l’Ain. Les autorités acceptent. » Pas de ligne de budget supplémentaire donc pas de souci : « En 2012, on a commencé à surveiller l’Ain et là on a vu (N.D.L.R. huit cas recensés au total). »
« On a refermé le couvercle »
Emmanuelle Amar fait remonter les informations en attendant que Santé publique France prenne les dispositions nécessaires. Mais c’est la médiatisation de l’affaire Depakine qui va faire bouger les choses : « Dominique Martin, président de l’Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé — aujourd’hui devenue l’ANSM), déclare en 2015 qu’il y a 368 cas en France depuis la mise sur le marché de la Depakine. Sur quatre départements, on en avait plus. Alors cette fois, on ne se tait pas et l’affaire est médiatisée. »
L’Inspection générale des affaires sociales (Igas) arrive en septembre 2015 pour vérifier les informations du Remera sur la Depakine. En partant, les trois inspecteurs demandent si d’autres signalements du registre sont restés lettre morte. Emmanuelle Amar sort son dossier des bébés sans bras. Et miracle : le 7 mars 2016, Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, annonce la création d’un registre national piloté par le Remera.
Dans la foulée, Emmanuelle Amar est convoquée par Santé publique France, qui refroidit ses espoirs : « Ils ont tout fait pour ne pas que ça se fasse. » Pire : « En septembre 2016, l’agence déclare qu’il n’y a pas d’excès de cas d’agénésie du membre supérieur dans l’Ain. On est douché. » En 2018, Santé publique France explique être allée dans l’Ain et n’y avoir rien constaté : « C’était faux. Depuis 2010 en réalité, rien n’a été fait. D’ailleurs après notre signalement, il y a eu d’autres cas, sans que cela n’émeuve nos interlocuteurs. »
Le gouvernement choisit finalement de confier l’enquête à un comité d’experts piloté par… Santé publique France. Plus rien ne sortira de cette affaire : « On a refermé le couvercle. »
« On sait que tout le travail effectué va partir à la poubelle »
Un alignement défavorable de planètes s’enchaîne pour le Remera. En 2016, Laurent Wauquiez est élu à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes : « En 2017, les financements de la région (100 000 euros) au Remera sont coupés. » La même année, Emmanuel Macron est élu président de la République. Exit Marisol Touraine, place à Agnès Buzyn. Fin septembre, l’Inserm coupe à son tour ses financements : « En septembre 2018, on reçoit une lettre de licenciement. »
Les médias vont sauver le Remera. Fin octobre 2018, RTL reçoit Agnès Buzyn. « Un journaliste nous propose de poser une question. On demande ce qui va être fait pour le “cluster” de l’Ain. La ministre annonce lancer un comité d’enquête et que l’on ne licencie pas une équipe qui travaille bien. »
Mais en 2023, cela ne semble plus poser de problème de licencier « une équipe qui travaille bien ». L’équipe reliée au CHU de Lyon est composée de cinq personnes : « Deux CDI et trois CDD, pour un budget annuel de 275 000 euros. » Depuis le début d’année, les CDD sont renouvelés de mois en mois. « C’est une façon de nous donner toutes les chances de perdre et nous empêcher de répondre à des appels d’offres qui peuvent s’étendre sur plusieurs années. Il y en a un sur la Depakine que l’on ne pourra pas avoir à cause de cela. » 2023 risque ainsi de signer la fin du Remera.
« Il n’y aurait plus de Vigie et de système d’alerte »
Qui pourra lancer l’alerte du prochain scandale sanitaire ? Combien de temps cela prendra-t-il et combien de victimes supplémentaires ? Emmanuelle Amar dénonce la défaillance dans la prise en charge des maladies environnementales. « Quand il y a une surproportion de cancers pédiatriques en Loire-Atlantique, par exemple, les familles le découvrent en se rencontrant dans la salle d’attente. Elles créent des associations pour pallier les défaillances de l’État. On va leur demander de prouver qu’il y a bien un cluster, et on finira par leur dire qu’il y a une faille dans leur méthodologie. C’est normal, on ne s’improvise pas épidémiologiste. »
Et à l’avenir, c’est bien ce qui risque de se passer dans l’Ain, la Loire, le Rhône et l’Isère : « Si le Remera disparaissait, il n’y aurait plus de surveillance du tout. Il n’y aurait plus de vigie et de système d’alerte. Ce serait un retour à la situation d’avant 1970. »
Et pour ceux qui se demanderaient où en est cette idée de registre national annoncée par la ministre en 2016 : « Aux oubliettes ! »
Clément Goutelle
Illustration : Zac Deloupy
1 Le scandale des bébés sans bras est résumé dans l’article dessiné « Podcast » de Deloupy (La Brèche, n° 2). Pour aller plus loin : la bande dessinée, Bébés sans bras. Un déni sanitaire, de Pierrick Juin et Mélanie Dechalotte, éditions Les Échappées.
2 Une agénésie transverse des membres supérieurs est l’absence de formation d’une main, d’un avant-bras ou d’un bras au cours du développement de l’embryon (source Santé publique France).
Après La depakine, les bébés sans bras, le scandale Remera ? Pour éviter un scandale sanitaire, un registre national semblerait le plus efficace. Mais Santé publique France (SPF) nous confirme que ce n’est plus d’actualité : « La mise en place d’un registre national n’a pas été recommandée par le Comité d’experts scientifiques (CES), compte tenu de l’importance des moyens et des contraintes organisationnelles que cela nécessiterait. » Une décision légèrement pipée, puisque ce CES est une émanation de SPF. Il est vrai que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même... Il existe aujourd’hui sept registres répartis sur le territoire qui « couvrent actuellement 19 % des naissances en France et couvriront avec l’intégration des données de ce 7e registre d’ici 2026 environ 26 % des naissances. » D’autres créations de registres en vue ? « Cela ne fait pas partie de la feuille de route publiée par le ministère de la Santé et de la Prévention. » Devant les arguments de SPF, Emmanuelle Amar tient à préciser que « la couverture géographique de la surveillance des registres a drastiquement chuté (on a perdu toute l’Alsace, 16 départements de la France Centre-Est et les Bouches-du-Rhône). L’ajout de la région de Bordeaux ne compense pas la perte de tous ces départements ». Et en ce qui concerne le Remera, depuis le 1er mai, « faute de financements, le registre ne surveille plus l’Ain, l’Isère et la Loire nord ». Et fin mai, il risque de définitivement fermer ses portes. Après les scandales sanitaires révélés, place à l’affaire Remera ?