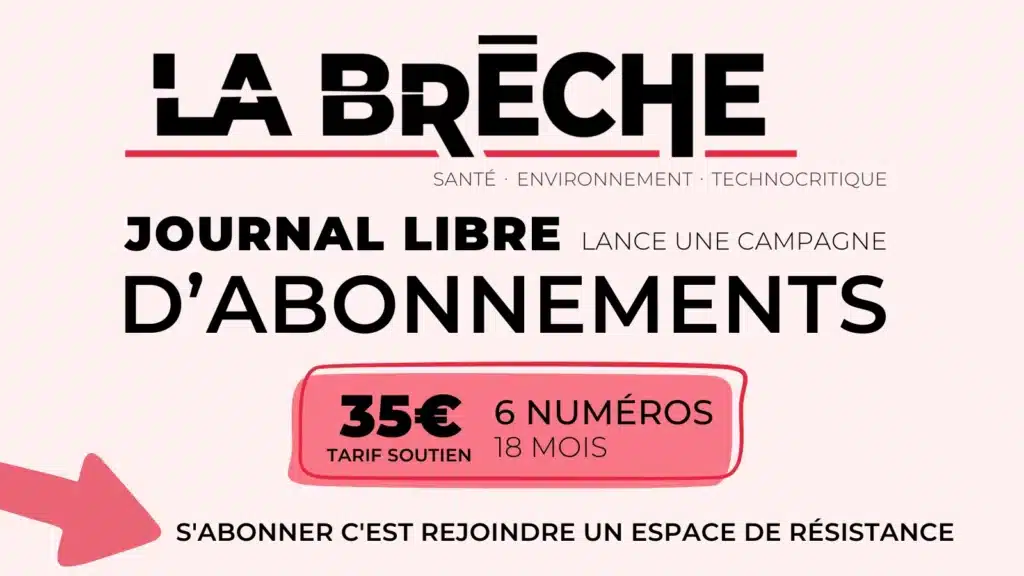Marcello Vitali-Rosati : « Le bug pour nous permettre de réfléchir autrement »
Glorifier le dysfonctionnement, et le vanter comme une source d’ouverture à d’autres possibles. Le pari est osé à l’heure du numérique omniprésent, synonyme d’efficacité et de performance. C’est pourtant le pas de côté que propose Marcello Vitali-Rosati, philosophe et professeur à l’université de Montréal. Auteur d’un Éloge du bug1, il invite à remettre en question la fuite en avant productiviste en profitant de ce qui grippe la machine pour s’arrêter… et réfléchir.
Vous expliquez notre appétence pour les outils numériques par un attrait pour ce qui est simple, pratique et performant. Comment l’expliquer ?
« C’est un attrait qui n’est pas naturel selon moi. Ce n’est pas quelque chose d’obligatoire et qui nous distinguerait en tant qu’être humain. Je pense que cela fait tellement partie de notre société et de notre manière de former des individus, que ça nous semble désormais naturel.
Francesco Orlando parlait de l’impératif rationnel. Selon lui, nous sommes formés à respecter un certain type de logique. Et nous sommes formés à refouler, à censurer toute sorte de logique qui ne correspond pas à cet impératif. Il estime que lors de la révolution industrielle, l’impératif rationnel s’est spécialisé en impératif fonctionnel : il faut que ça marche. Cette idée est tellement présente que nous n’arrivons pas à trouver cela possible de réfléchir autrement. D’accord, ça fonctionne mais est-ce la seule chose qui compte ?
Aujourd’hui, des usages se mettent en place pour déléguer des tâches à des agents conversationnels, comme faire des résumés ou structurer la bibliographie dans le cadre de publications dans des revues scientifiques. C’est simple, c’est rapide, et on gagne du temps. On finit par publier des milliers d’articles que personne ne lit, mais on se félicite parce que ça marche bien. On a complètement perdu le sens de pourquoi on le fait. Dans certains cas, mon objectif peut être que ça fonctionne, que ce soit simple et rapide. Mais dans de nombreux cas, je peux avoir envie d’autre chose. La littérature, par exemple, suit une autre forme de logique. Le travail que nous devrions faire est de rendre visible cet impératif fonctionnel pour comprendre qu’il n’est pas naturel. Ce n’est pas une fatalité. »
« C’est lorsque ça ne marche pas que l’on se pose la question de ce que l’on voulait vraiment faire »
Qu’est-ce que le rejet absolu du dysfonctionnement dit de nos sociétés ?
« Je vois le rejet de tout ce qui ne correspond pas à l’impératif fonctionnel comme un refoulement de la multiplicité et de la diversité. Ce qui est pour moi le plus inquiétant n’est pas d’être dans une société capitaliste, pour laquelle l’impératif fonctionnel est évident. Ma préoccupation principale est la destruction systématique de tout autre modèle. Le fait que ça ne marche pas propose une multiplicité, une ouverture vers quelque chose qui n’a pas été prévu. C’est là la beauté du bug : se poser la question du modèle, de la vision du monde poursuivie dans ces moments particuliers. C’est lorsque ça ne marche pas que l’on se pose la question de ce que l’on voulait vraiment faire.
L’important est qu’il y ait un “non” possible. Lorsque je lis par exemple, je peux avoir une lecture fonctionnelle, méditative, académique… Et ce doit être vrai pour toutes les choses que l’on veut faire dans sa vie. Un GPS va nous donner le meilleur itinéraire. Oui mais le meilleur par rapport à quoi ? On peut avoir des attentes très différentes : passer par des jolies ruelles, voir le moins de monde possible… »
Quelle vision du monde est portée par les géants du numérique et les outils qu’ils développent ?
« Je dirais que la caractéristique principale est une adhésion totalisante à l’impératif fonctionnel. “Le numérique” est là pour donner “la solution” à tous les problèmes. Il faut d’ailleurs souligner que le terme numérique désigne simplement le fait d’utiliser une représentation à l’aide de valeurs chiffrées. On peut modéliser par ce biais tout et n’importe quoi, de manière diverse. Les représentations sont multiples, il faudrait donc parler “des numériques”. Quand on parle du numérique au singulier, on pense qu’il y a une nécessité d’uniformisation des usages, des visions du monde, des applications… Alors que ce n’est pas vrai ! On assiste à une uniformisation en effet, mais celle-ci ne dépend pas du numérique lui-même, mais de sociétés gigantesques qui centralisent les usages et imposent leurs modèles et leurs représentations. Aujourd’hui, “le numérique” est donc la vision du monde portée par cette poignée d’entreprises.
Dans celle-ci, il y a notamment une interprétation particulière de ce que signifie la liberté. Être libre signifie être délivré, être affranchi de toute tâche que l’on considère comme triviale. Cette idée-là amène finalement à une perte totale de la liberté en tant qu’autonomie, dans le sens où on délègue, par exemple à des applications, et on laisse faire. »
Quel rôle peut jouer le bug dans notre émancipation vis-à-vis de ces outils ?
« La grande limite de mon discours critique est : qui peut se permettre de l’écouter et de le mettre en place ? Par exemple, qui peut se permettre de ne pas avoir un smartphone ? Personnellement, je le peux car je suis un privilégié : universitaire, bien payé, sans patron, entouré de connexion… De la même manière, qui peut se permettre d’aller lire des articles détaillant le fonctionnement profond de ces outils ? Appeler à résister de cette manière serait réservé à une élite de privilégiés. C’est là que le bug intervient. C’est cet élément étranger qui arrive, qui bloque tout, qui empêche le fonctionnement normal. Il déclenche cet espace autre et permet la constitution d’une pensée différente. C’est ce qui m’intéresse et permet l’émergence de modèles qui ne dépendent pas d’un individu mais que des groupes peuvent s’approprier. L’espoir pour moi est qu’il restera toujours une multiplicité de collectifs qui permettent à des modes pluriels de pensée de continuer à exister. »
Propos recueillis par Jp Peyrache
Illustration : Olivier Paire
Paru dans La Brèche n° 12 (juin-septembre 2025)
- Vitali-Rosati, Marcello, Éloge du bug. Être libre à l’époque du numérique, Éditions La Découverte, 2024 ↩︎
- Acronyme désignant les géants états-uniens du numérique : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft ↩︎
Numérique : une éducation plutôt qu’une « adhésion aux Gafam »
Pour Marcello Vitali-Rosati, il est essentiel de comprendre comment fonctionne le numérique, et cela passe selon lui par « une éducation à une véritable littératie numérique, et non pas simplement l’adhésion aux Gafam2. Je serais ravi si on pouvait apprendre aux plus jeunes à démonter un ordinateur, comprendre comment fonctionne un protocole, ce qu’est un algorithme... ». Le philosophe regrette par ailleurs l’influence des lobbies dans les instances publiques : « Apple a un grand rôle là-dedans. Comme si l’éducation au numérique consistait à devenir accro à l’iPad. Il ne s’agit pas d’apprendre à utiliser, mais d’enseigner, former et donner les outils pour pouvoir comprendre. Évidemment que n’importe qui sait utiliser un téléphone, étant donné notre niveau d’exposition. Mais il ne faut pas s’en féliciter, c’est plutôt un problème car le recul critique n’existe aucunement. »