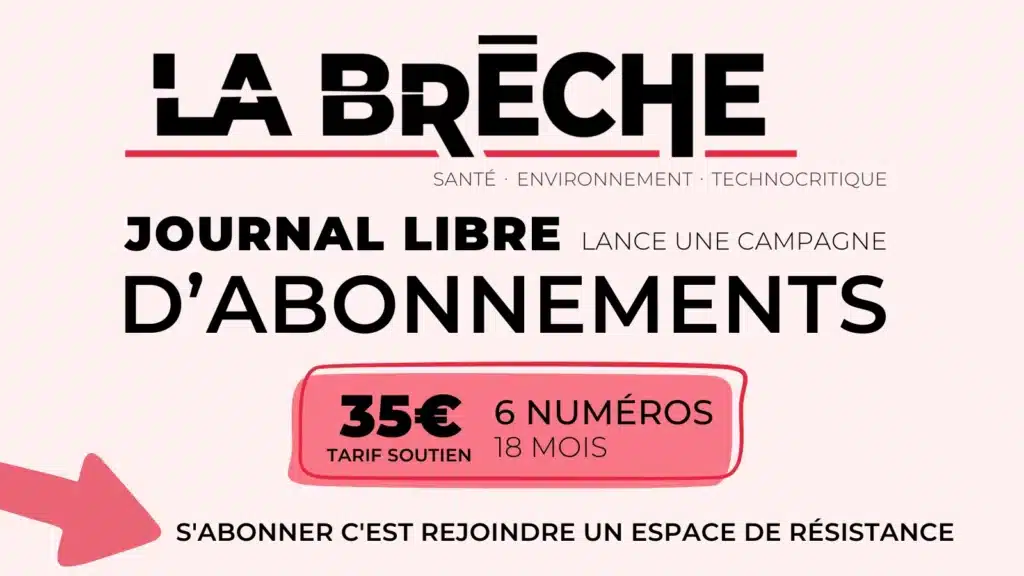LGV Bordeaux-Toulouse : à toute vitesse face à l’inconnue des fantômes de roche
Les fantômes de roche sont des zones de grande porosité du calcaire, potentiellement instables. C’est l’un des arguments des opposants à la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Ils alertent sur les complications à venir d’une ligne ferroviaire bâtie sur des zones géologiques fragilisées, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires.
Nous sommes en octobre 2024, dans le sud de la Gironde. Les associations opposées au projet de ligne à grande vitesse (LGV) entre Bordeaux et Toulouse organisent un week-end de mobilisation. Sur le stand de l’association LGV Nina (Ni ici ni ailleurs), un militant déroule ses arguments. L’artificialisation des terres, le coût considérable pour gagner une heure de trajet, mais pas seulement : « Un géologue nous a parlé de la fantômisation de la roche calcaire. SNCF Réseau n’aurait pas du tout pris en compte cet élément dans le projet » De quoi s’agit-il ?
Richard Maire, géologue honoraire au CNRS, à Pessac, dans la métropole bordelaise, nous explique : « La fantômisation, c’est la roche en place qui devient poreuse suite à une altération bactérienne. Tant que c’est plein d’eau ça va, mais si la nappe phréatique descend, ces zones de porosité peuvent se vider, et engendrer des effondrements. On l’a constaté dans la région. » Il y a cinq ans, par exemple, un trou s’est formé au niveau de la gare de Podensac, au sud de Bordeaux.
En l’état, ce phénomène de création de vides souterrains constitue un énième argument à l’encontre du projet ferroviaire. « Les rails ne peuvent pas supporter le moindre affaissement, même de 1 ou 2 centimètres sur une longueur de 100 mètres (ndlr, la plateforme ferroviaire, elle, peut encaisser quelques variations). En contrepartie, il faut beaucoup de travaux de prévention pour que ça ne se produise pas. Ils vont par exemple devoir faire des injections de béton pour combler ces vides », assure le géologue, par ailleurs militant anti-LGV.
Un paradigme scientifique récent
À quand remonte la découverte de ce nouveau paradigme scientifique sur la formation des vides souterrains ? Yves Quinif, géologue belge auteur d’un article sur le sujet1, nous ramène au milieu des années 1990. Il assiste alors à la création de la grotte Quentin, en Belgique, en une décennie. « L’eau de la nappe est ressortie à la base de la carrière en passant au travers du calcaire altéré. Cela a dégagé 110 mètres de galeries. Quelques années auparavant, la grotte n’existait pas. »
Avec Richard Maire, ils produisent un article de recherche2. En 2002, un premier colloque sur la fantômisation est organisé. La théorie est implantée. Avec le concept de fantômisation, les géologues et karstologues expliquent la formation de certaines grottes en deux phases : une altération bactérienne du calcaire lorsque celui-ci se trouvait au niveau de la nappe phréatique, il y a parfois vingt à trente millions d’années comme en Gironde, puis un lessivage de la roche altérée par des eaux souterraines. Des cavités peuvent ainsi se créer en quelques années.
« Ça a fait un boucan terrible »
13 décembre 2024. Richard Maire, 75 ans, m’attend à la gare de Podensac, en Gironde. Tout près se trouve l’effondrement de Virelade, qui est l’un des exemples les plus évocateurs du phénomène de fantômisation dans la région. Au cœur de la forêt, un gigantesque trou est apparu à la surface, en 1983 : « Ça a fait un boucan terrible : des gens qui vivaient à deux kilomètres l’ont entendu en pleine nuit. »
Le géologue emprunte un chemin forestier cabossé. Nous poursuivons à pied. Nous voilà devant l’effondrement, protégé par une clôture percée. Le trou fait 24 mètres de diamètre, et il faut descendre 12 mètres plus bas pour se retrouver nez à nez avec le calcaire. « Il y a encore 10 ans, on pouvait accéder à une grotte et on voyait la nappe phréatique vers 17 mètres de profondeur », se souvient le géologue.
Les flancs sont encore bien nets. Cela permet de voir les couches géologiques, décrites par mon guide du jour : « Il y a d’abord 10 mètres d’anciennes alluvions, des graves et du sable, avant d’arriver au calcaire. » Ce dernier intéresse fortement les géologues. Une grande partie serait touchée par le phénomène de fantômisation, à l’origine de l’effondrement de Virelade.
« Des effondrements et des risques d’effondrement à proximité du tracé »
Rapport de la commission d’enquête publique de 2015
Dans la pente, sous le poids de nos corps, le sable et les graviers s’affaissent. Au fond du trou, Richard Maire frappe la roche calcaire encore à nu, à l’aide d’un marteau. « Au son, on arrive à connaître la porosité. Là on est à 50 % de porosité. » Le géologue trouve une zone d’impact plus proche du sol. Le calcaire, très poreux, se réduit en poudre. Il insiste. Un mini-éboulement se déclenche sous ses coups de butoir. « C’est pourri, pourri. Il y a des dizaines de kilomètres comme ça, et la LGV passera dans les terres du Sauternais et de la vallée du Ciron, également concernées », précise Richard Maire. Dans une thèse du géologue Benjamin Lans qui se penche sur la fantômisation en Gironde, publiée en 20143, deux forages du BRGM (service géologique national) réalisés à 2 et 4,5 km du site de Virelade sont mentionnés. Les deux révèlent une roche calcaire très poreuse sur 24 et 16 mètres d’épaisseur dans le sous-sol. Un contexte « favorable à la formation de vides importants » souligne le chercheur.
Ce risque n’est pas mentionné dans l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique produite par SNCF Réseau en juin 2014. Seul le rapport de la commission d’enquête publique de 2015 alerte sur de possibles effondrements qui auraient des impacts sur les captages d’eau potable : « Des chercheurs en karstologie signalent la présence de dolines (ndlr, petites cuvettes pouvant mesurer de dix à plusieurs centaines de mètres de diamètre), des effondrements et des risques d’effondrement à proximité du tracé. »
Des phénomènes d’effondrement par processus de fantômisation ont été constatés en Belgique. À Tournai, un trou s’est formé à 5 mètres de la ligne TGV. Dans un canal à Beloeil, la rive a été absorbée dans la nappe phréatique. En France, en 2004, un effondrement à proximité de la route nationale 141 en Charente, au niveau de Chasseneuil-sur-Bonnieure, a fait l’objet d’investigations qui ont mené à la découverte de la grotte de la Fuie. Pour éviter tout nouvel effondrement ou affaissement, des comblements et renforcements des galeries ont été effectués à l’aide de béton.
Un problème pour plus tard
En vérité, ce problème ne semble pas être pris en considération pour le moment. « C’est faux de dire qu’ils n’ont pas du tout pris en compte la formation de cavernes. Ce qui est vrai, c’est que ce ne sont pas des problématiques qui se posent en avant-projet simplifié. Ça ne viendra que dans la phase de travaux qui va démarrer », expose Hubert Camus, géologue et docteur en karstologie qui a travaillé sur les projets des LGV Est, Méditerranée et Rhin-Rhône (pour la société Bardot et Compagnie).
Le géologue a déjà travaillé sur des chantiers ferroviaires qui devaient composer avec la fantômisation : « Les promoteurs du projet devraient avoir cette information avant d’entamer tous travaux. En réalité, ça ne se passe jamais comme ça. Les désordres ne vont intervenir qu’en phase projet, et ils nous feront venir pour qu’on leur dise des trucs qu’ils n’ont pas forcément envie d’entendre. »
Hubert Camus, qui a étudié les sols de la région, identifie le risque sur près de 100 kilomètres entre Bordeaux et le sud-ouest du Lot-et-Garonne, à Casteljaloux. Ces sous-sols calcaires accueilleront la voie ferrée à grande vitesse Bordeaux-Toulouse d’ici 2032. « L’Oligocène est bouffé par la fantômisation, donc des secteurs comme Virelade, déclenché par une variation du niveau de la nappe, il y en aura tout le long. » Le chantier de la LGV pourrait aussi modifier l’écoulement des eaux souterraines, et entraîner des tassements dans les zones de fantômes pas encore évacuées, avec des problèmes de stabilité en surface. La durée des travaux, de 5 à 8 ans, rajoute une part d’imprédictibilité : « Une cavité a le temps de se former sous une zone sensible. »
Plus de béton et plus de millions
Rien d’insurmontable pour un chantier de cette ampleur. Mais la recherche de solutions se fera probablement au détriment du reste. « Il va falloir plus de béton dans les sols pour solidifier l’ouvrage. La facture va s’alourdir fortement, tout ça avec de l’argent public, pour qu’une minorité de personnes aillent un peu plus vite », regrette Richard Maire.
Le maître d’ouvrage SNCF Réseau est-il conscient du phénomène de fantômisation qui frappe les sols calcaires de la région ? À quel moment du projet va-t-il se pencher sur la quantification du phénomène autour du tracé et quelles solutions peuvent être envisagées dans les zones concernées ? Nous aurions aimé avoir des réponses à toutes ces questions en suspens. Malheureusement, la société Géotec, chargée de mener les sondages du sol, a refusé de répondre à nos questions pour des raisons de « confidentialité ». SNCF Réseau, à qui nous avions transmis nos questions, les a simplement ignorées, malgré une dizaine de relances. Comme les fantômes de roche.
Nicolas Beublet
Illustration : Martin Texier
Paru dans La Brèche n° 12 (juin-septembre 2025)
- « La fantômisation : une nouvelle manière de concevoir la formation des cavernes », Regards no 79, 2014 ↩︎
- « La Grotte Quentin (Hainaut, Belgique) : un modèle d’évolution des fantômes de roche », Karstologia Mémoires, 2009 ↩︎
- Lans, Benjamin, Genèse des systèmes karstiques de Gironde (Entre-Deux-Mers et Graves), 2014 ↩︎
GPSO, un projet ferroviaire contesté
La particularité du Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), c’est qu’il unit contre lui. Un pôle parlementaire d’élus girondins de tous bords politiques s’est constitué, et vingt collectifs locaux sont répertoriés. La première phase du projet vise à construire 200 kilomètres de nouvelles lignes pour gagner une heure de trajet entre Paris, Bordeaux et Toulouse. Le tout en artificialisant 4 800 hectares de terres, d’après les opposants, et pour un coût estimé à 14 milliards d’euros en 2020. En mars 2015, la Commission d’enquête avait émis un avis défavorable à la déclaration d’utilité publique sur cette ligne à grande vitesse. La phase 2 du projet vise à réaliser une bifurcation de la ligne vers Dax, afin de positionner progressivement la grande vitesse ferroviaire vers l’Espagne.