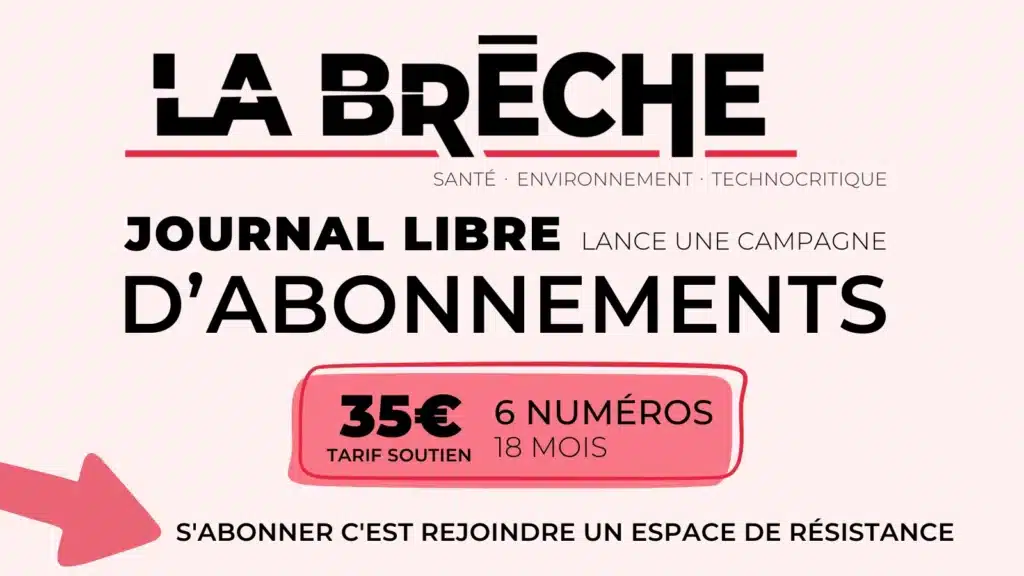Frontières, minerais et armes : triple peine pour les jeunes de Goma en RDC
À l’Est de la RDC (République démocratique du Congo), les jeunes de Goma, ville-frontière adossée au Rwanda, n’ont jamais connu que les cycles infernaux des conflits armés qui sévissent depuis trente ans dans le Nord-Kivu. La prise de la ville par les rebelles du M23 en janvier dernier marque un nouveau chapitre de l’histoire de leur ville et de celle du pays tout entier. Jamais ces enfants de la guerre, qui n’aspirent qu’à la paix, n’avaient été exposés à un tel niveau de violences, d’angoisses et d’incertitudes.
Rien ne transparaît derrière le sourire d’Alain*, aussi tranquille que les eaux émeraude du lac Kivu qui bordent Goma et ses 2 millions d’habitants, à près de 3 000 kilomètres de la capitale Kinshasa. Derrière le jeune chauffeur de 26 ans, un paysage paradisiaque de végétation luxuriante dans une ville engourdie et presque vide, un samedi soir. Alain assume de faire semblant. « Je ne veux pas paraître faible », assure-t-il, en grimpant dans la voiture qu’on lui a prêtée. La sienne a été vandalisée par un groupe de bandits armés avant d’être retrouvée par des soldats du M23, mais inutilisable. Il ignore s’il aura, un jour, les moyens de la faire réparer. Au moins, les bandits qui l’ont attaqué, fusil sur la tempe, n’ont pas violé sa jeune épouse et ne les ont pas tués, comme ils le font parfois pour effacer leurs traces. Un miracle. « Je ne m’en remets pas. Chaque soir, je revis les événements et je n’arrive pas à m’endormir. »
Même si le M23, soutenu par le Rwanda, assure que le calme est revenu à Goma, ses habitants éprouvent un profond sentiment d’insécurité, après les effroyables combats de fin janvier qui ont vu la victoire de la rébellion sur l’armée congolaise, les Forces armées de la république démocratique du Congo (FARDC), et leurs alliés. Les bombes, les balles perdues, les règlements de comptes, les scènes de pillages apocalyptiques, les viols et les cadavres partout dans les rues. Ce que certains appellent de façon un peu épique « la bataille de Goma », d’autres sa « libération ». Depuis qu’ils sont nés, les jeunes de Goma ont toujours entendu crépiter les armes. « Les voisins font cuire du maïs », les rassuraient leurs parents quand ils étaient enfants.
La prison pour avoir osé dénoncer la corruption et la mauvaise gouvernance en RDC
« J’avais deux ans, quand la première fois j’ai été un déplacé de guerre », raconte Christian, 30 ans. D’un naturel plutôt joyeux, cet activiste depuis ses dix-huit ans a été confronté maintes fois aux arrestations musclées et aux séjours à Musenze, la sinistre prison de Goma, pour avoir osé dénoncer la corruption et la mauvaise gouvernance en RDC. Mais cette fois-ci, il parle de dépression. « On a tous été traumatisés, martèle Imani, un musicien de 27 ans. C’est pour ça que la clinique de santé mentale propose des séances gratuites pour tous les habitants. » Pour Violette, 27 ans, commerçante sur le marché, « la ville donne l’impression d’être calme, mais c’est pire qu’avant ».
La paix, les jeunes de Goma ne l’ont jamais vraiment connue. Ils en font des slams, des dessins, des chorégraphies et même, depuis 2014, un festival qu’ils ont baptisé « Amani », paix en swahili. L’art comme forme de résilience. Le mot revient sans cesse dans ce Kivu toujours en pointe du combat démocratique. Une capacité à rester debout qui fait d’eux des « cascadeurs », comme ils se qualifient, habitués à se débrouiller. « J’ai appris à utiliser les moyens du bord, raconte Diane, 26 ans, étudiante en dernière année de médecine qui s’est retrouvée à soigner des blessés par balles dans un hôpital démuni de tout. Quand je n’ai pas d’attelle, j’utilise un carton pour en fabriquer une. »
La guerre remonte à 30 ans en arrière. Juillet 1994, Goma, alors petite bourgade, assiste à l’arrivée de centaines de milliers de Hutus rwandais emmenés par des responsables du génocide des Tutsis. Militaires et miliciens ont pris la population en bouclier, fuyant l’armée des exilés tutsis qui met fin aux tueries au Rwanda. Un million de morts en trois mois dans ce minuscule pays, à peine plus grand que la Bretagne, alors que le Zaïre (l’ancien nom de la RDC) s’étend sur un territoire aussi grand que toute l’Europe occidentale. Trente ans plus tard, l’idéologie raciste anti-tutsi, produit de la colonisation européenne, continue de prospérer. Les Tutsis y passent pour un groupe d’étrangers n’appartenant naturellement pas au territoire congolais, victimes, depuis les années 1960, de discours de haine, chasses à l’homme, tueries. Plusieurs dizaines de milliers de Tutsis congolais peuplent les camps de réfugiés des pays voisins depuis des décennies. L’une des revendications du M23 concerne le retour de ces réfugiés en RDC. Son nom rappelle que les accords du 23 mars 2009, qui le prévoyaient, n’ont jamais été appliqués. « C’est une histoire qui se répète, assure Imani, énumérant guerres et rebellions qui ont précédé le M23, en 1996-1998, puis en 2004-2009, ou encore en 2012. C’est pour ça que c’est fatiguant. »
La protection des populations tutsies congolaises justifie, pour le Rwanda, son soutien au M23 d’autant que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a repris à son compte un discours qui prête une pulsion guerrière et expansionniste aux Tutsis et donc au président rwandais Paul Kagame. Comparant le minuscule Rwanda à la Russie en Ukraine, Tshisekedi a même intégré à l’armée congolaise les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), une milice fondée par d’anciens génocidaires.
« Les minerais, on dirait que c’est un péché d’en avoir »
Albertine, 32 ans, couturière,
Jeune tutsie congolaise, Gentille ne pense pourtant pas que le M23 soit venu défendre sa communauté : « Je pense qu’ils veulent s’emparer de toute la RDC et qu’ils vont réussir ». Albertine, 32 ans, couturière, ne croit pas aux « bonnes intentions des rebelles. Ils veulent la richesse du sous-sol. Les minerais, on dirait que c’est un péché d’en avoir. Certains pays n’en ont pas et les gens vivent bien ». Approché par le M23 avant la chute de Goma pour l’intégrer, Christian a décliné la proposition, arguant que « les armes n’ont jamais rien résolu en RDC ». Cependant, l’activiste n’avait pas prévu un tel déferlement de violences. « Si on nous dit qu’il y a eu plus de 3 000 morts, cela signifie qu’il y en a sûrement eu le double ou le triple », estime Imani.
En janvier, après les combats, les soldats FARDC, abandonnés par leurs officiers et privés de leur solde qu’accaparent les généraux de l’armée congolaise, ont très vite semé la terreur. Ils se sont fondus dans la population, avec les miliciens Wazalendos (terme générique désignant des groupes d’autodéfense actifs en RDC) et les bandits sortis de prison. Tous ont multiplié attaques, vols, viols et tueries. Le M23 s’est mis à traquer tous ceux qui ont la survie au bout du fusil. « Ça a été l’un des moments les plus compliqués de ma vie. Chaque jour, c’étaient des camarades décédés, des amis arrêtés et des gens disparus », explique Christian qui, très vite, a quitté Goma pour se réfugier dans un pays d’Afrique de l’Est.
« Il y a moins de violence car tout le monde a peur d’être fouetté »
Lincan, 20 ans, étudiante en agronomie
La ville est méconnaissable, vidée d’une partie de ses habitants. « Il ne reste que les pauvres et ceux qui n’ont aucun endroit où se réfugier à l’étranger », remarque Alain. Malgré tout, pour maintenir l’ordre dans une ville de deux millions d’habitants comme Goma et l’administrer, le M23 a déployé massivement ses troupes dans la ville : tout contrevenant s’expose au fouet ou à une exécution immédiate. En même temps, pour gagner la confiance de la population, l’électricité a été rétablie et l’eau distribuée gratuitement. Goma est devenue propre et sûre, au moins le jour, sans racket. Même les enfants des rues ont disparu. Et le M23 a interdit les châtiments corporels à l’école. « Il y a moins de violence car tout le monde a peur d’être fouetté. Aujourd’hui, tout le monde s’arrête au feu rouge. Avant, personne ne respectait le code de la route », raconte Lincan, 20 ans, étudiante en agronomie.
Le M23 a même mis en place un numéro d’intervention en cas d’attaque nocturne. Mais, appelé sur d’autres fronts, il a réduit sa présence sur le terrain : « La nuit, on a peur du sommeil », témoigne Violette. « Nous, les filles, comme nos mères et nos grands-mères, on dort toutes en pantalon, confie Nyota, dessinatrice de 25 ans. Mais, maintenant, je peux marcher sans crainte dans la rue en dépit de mon physique de Tutsie qui me valait d’être agressée, même si je ne le suis pas. »
Vanessa, comme de nombreux autres jeunes de Goma, a déménagé de l’autre côté de la frontière, dans la ville rwandaise de Gisenyi, désormais peuplée de Congolais, mais elle n’est pas retournée sur les bancs de la fac. « Malgré tous les efforts que ces gens font pour ramener la confiance de la population, moi, à Goma, j’ai toujours peur ».
Les yeux rivés sur les réseaux sociaux et les boucles WhatsApp, les jeunes Congolais voient défiler des images d’atrocités et des témoignages terribles. Et, à Goma, les rumeurs circulent vite. Comme celle, pas totalement infondée, de l’enrôlement de force, car le M23 a besoin d’hommes. Et même d’enfants qui parfois n’ont pas dix ans. De nombreux jeunes ont volontairement rejoint le M23, moins pour épouser leur cause que par instinct de survie. Vanessa s’inquiète pour son petit frère : « Des enfants de 13 ou 15 ans ont été enlevés dans les écoles par les rebelles. Le M23 a dit aux parents de venir les récupérer avec un justificatif prouvant qu’ils n’étaient pas miliciens. Certains parents ont retrouvé leur fils, d’autres pas. »
Daniel, taxi de 25 ans, s’est lui aussi installé à Gisenyi : « Ici, il n’y a pas de travail, mais au moins on se sent à l’abri. » Ses rares clients sont à Goma. Une course à 10 dollars lui permet de subvenir à ses besoins pendant trois jours. Mais combien de temps pourra-t-il tenir ? Les banques ont fermé. Les organisations internationales ont quitté la ville. Tout le monde est en manque d’argent cash, même le M23 qui crée de nouvelles taxes ou amendes. Et ses dernières recrues, souvent d’anciens FARDC, se mettent à réclamer de l’argent à la population, n’étant pas assez ou pas encore payées.
Sans illusion sur la rébellion, Daniel juge très durement le président de la RDC à qui il reproche, mû par son orgueil, de n’avoir pas su éviter les milliers de morts. « On est entre le marteau et l’enclume. Notre malheur, c’est d’être nés au Congo, un pays très riche mais dont la richesse ne profite pas à sa population. » Christian n’a pas de mots assez durs contre le gouvernement de Kinshasa : « On ne serait pas dans cette situation s’il avait su protéger la population et bien gérer la situation. Moi je blâme Tshisekedi et tous les médiocres qui l’entourent. Il n’y a aucune lueur d’espoir. »
Plus que jamais les jeunes de Goma envisagent de s’exiler. Imani ne compte pas faire sa vie au Congo. Nyota, si elle avait les moyens, partirait. Daniel songe à rejoindre le M23 qui pourrait l’embaucher. Lincan, elle, s’avoue fatiguée : « J’ai le sentiment d’avoir grandi dans un pays d’irresponsables plus que dans un pays en guerre. Et ce n’est pas une fierté. J’ai envie de voir ce pays changer. »
* Tous les prénoms ont été modifiés
Camille Legrand
Illustration : Zac Deloupy
Paru dans La Brèche n° 12 (juin-septembre 2025)
Les richesses de la RDC n’expliquent pas tout
Il y a des mines partout à l’est de la RDC (République démocratique du Congo) : or, coltan, cassitérite... Extraits par les Congolais, ces minerais sortent du pays à l’état brut, souvent en fraude pour éviter les taxes, et sont revendus en Ouganda, au Rwanda, mais aussi au Burundi. Autant de pays attentifs à la sécurisation des axes commerciaux. Cependant, la guerre des minerais, mise souvent en avant, passe sous silence l’aspect politique, fondamental, lié aux conséquences du génocide des Tutsis. En paix depuis 1994, le Rwanda a en effet basé toute sa politique sur un postulat sécuritaire. Il entend éliminer toute menace. Comme la présence à ses portes d’anciens génocidaires hutus qui propagent leur idéologie anti-tutsie en RDC, avec pour projet de renverser le régime de Kigali. Le M23 permet ainsi au Rwanda d’avoir une zone tampon qui, à défaut de l’éliminer, repousse la menace.