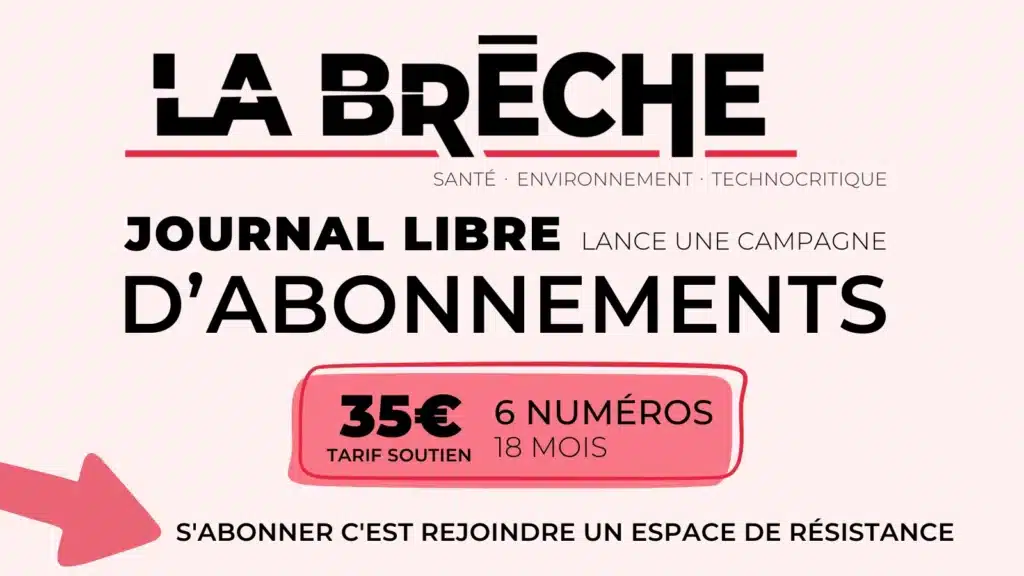Cyberféminismes : des serveurs pour bâtir des refuges numériques
Les cyberféministes défendent depuis longtemps la nécessité de déployer des refuges numériques. Sans le vouloir, l’administration Trump, qui s’adonne à des purges numériques massives, démontre la pertinence de ce mouvement. Entre serveurs autogérés, archivage des mémoires et déploiement d’espaces sécurisés en ligne, il dessine des moyens de résister à la censure, mais aussi à la surveillance et à l’influence des grandes plates-formes.
Les décrets frénétiquement signés par Donald Trump à son investiture à la Maison Blanche ont eu des effets immédiats sur la mémoire numérique. Entre janvier et février 2025, plus de 8 000 pages web officielles du gouvernement fédéral ont été supprimées selon le New York Times1. Des « purges informationnelles » qui ont visé en premier lieu les contenus liés aux féminismes, aux luttes et aux existences des personnes LGBTQIA+, mais aussi les données écologistes ou relatives aux mouvements de justice sociale. Des attaques aussi éclair que brutales qui rappellent à quel point il est facile, en seulement quelques clics, de faire tout bonnement disparaître certaines réalités d’internet. Bien au fait de cette fragilité de l’espace numérique, une partie du mouvement cyberféministe développe depuis plusieurs années des alternatives qui permettent une reprise de contrôle sur les outils numériques – et les mémoires qui y reposent.
« Les géants de la Tech ont retiré leur vernis de politiquement correct en janvier. Mais l’émancipation numérique est un enjeu qu’on met en avant depuis 2008 », ironise Spider Alex, une des fondatrices du collectif technoféministe catalan Donestech. Dans une optique de cyberféminisme social, elles cherchent depuis leur création à comprendre comment fonctionnent les technologies du numérique, afin de se les réapproprier et de les mettre au service des luttes. « À l’époque, la revue féministe espagnole Pikara nous avait demandé de l’aide. Leur site web était régulièrement inaccessible, car les vidéos d’une de leurs journalistes, Alicia Murillo, qui filmait les hommes qui faisaient du harcèlement de rue, étaient très critiquées sur les réseaux sociaux commerciaux. Elles recevaient des milliers de visite, et ces pics faisaient tomber le site web. Mais comme leur site web était hébergé par un hébergeur commercial privé, celui-ci n’intervenait pas pour le restaurer – parce qu’il n’accordait pas d’importance aux contenus et à leur dimension politique », se remémore la militante. Dès lors, apparaît la nécessité de rechercher la souveraineté à toutes les étapes, notamment du côté de l’infrastructure physique et logicielle qui permet à un site d’être accessible en ligne. Les membres de Donestech créent ainsi « l’anarchaserver » : un serveur cyberféministe, maintenu par et pour les militantes, sur lequel sont stockées des données liées à la mémoire des luttes féministes – plutôt que de confier ces informations à des tiers privés ou commerciaux.
Nos données sur nos machines
« Nous accordons une grande importance à la protection de la vie privée et de la sécurité. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous maintenons notre propre infrastructure en dehors des services de cloud des grandes entreprises et utilisons principalement des logiciels libres », nous explique le collectif brésilien Marialab. Sur leurs serveurs cyberféministes, elles hébergent des outils à destination des défenseuses des droits humains et des organisations de lutte sociale – comme des pads ou éditeurs de texte collaboratifs et des boîtes mail sécurisées. En étant à la fois propriétaires des machines et en ayant un regard sur les lignes de code, elles ont le contrôle sur les règles qui régissent leurs activités en ligne.
Les cyberféministes défendent la formation à toutes les compétences informatiques, y compris celles qui relèvent de l’administration système et du code – et ce, en particulier à destination des femmes et des minorités de genre, moins socialisées à se saisir des outils du numérique. Une démarche d’autant plus importante que les géants du numérique comme Meta et Amazon ont été prompts à supprimer, sous l’influence de l’administration Trump, leurs programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). À Strasbourg, l’association Hackstub – et sa branche en mixité choisie, sans hommes cisgenres hétérosexuels, Hacqueen – se veut un espace d’éducation populaire. « On explique comment protéger sa vie numérique, aussi bien face aux agressions du capitalisme – comme le vol de données personnelles – que face à du cyberharcèlement ou à la violence d’un ou d’une ex-conjoint·e en ligne », explique Camille, bénévole de l’association depuis quatre ans. Face à l’effacement des minorités en ligne, elles travaillent également à l’élaboration d’archives queer militantes auto-hébergées et auto-gérées, pour sauvegarder des données féministes – à travers des ateliers d’archivage, qui recouvrent aussi bien les techniques de scraping (l’extraction de données) que les architectures informatiques qui permettent ensuite de les protéger.
Mais faire vivre ces infrastructures d’internet autonome est une pratique militante exigeante. Là où l’internet commercial s’appuie sur une armée de techniciens et d’immenses data centers, l’auto-hébergement repose sur des collectifs engagés, souvent bénévoles, qui doivent composer avec les limites de leur temps, de leurs ressources, et d’un écosystème logiciel en constante évolution.
Des sites web résilients, « un moyen concret de préserver la mémoire collective »
Ana, membre de la coopérative Sutty
Car au-delà de la censure, ce sont aussi les failles techniques qui fragilisent la mémoire numérique. Une étude du Pew Research Center estime qu’entre 2013 et 2023, près d’un site web sur trois a tout simplement disparu d’internet2. C’est ce qui a poussé Elio et Fauno, ancien·nes administrateur·ices de serveurs cyberféministes argentins, à chercher d’autres solutions : « On s’est demandé “comment héberger des sites plus résilients et qui ne demandent pas tant d’implication militante ?“, parce qu’il nous arrivait de passer des nuits entières à résoudre des problèmes techniques. »
En 2019, ils cofondent Sutty, une coopérative et ONG qui conçoit et héberge des sites plus sobres, durables et autonomes, en s’appuyant sur les technologies dites statiques ou pré-générées (ndlr, des pages web dont le contenu reste le même chaque fois que les visiteurs y accèdent, à l’inverse des sites internet dits « dynamiques », constamment régénérés). Moins exigeants à maintenir, moins vulnérables aux attaques, ces sites deviennent aussi plus résistants à l’effacement. La coopérative mène également un travail de sauvetage de sites militants. À ce jour, elle a restauré six plates-formes liées à la défense des territoires ou aux droits humains, comme desarquivo.org, site brésilien qui compilait quinze ans d’archives décoloniales et féministes, devenu inaccessible faute de mises à jour. En le remettant en ligne via des protocoles distribués, elle garantit que les données ne reposent plus sur un seul serveur centralisé, mais sur un réseau de machines – qualifié d’égal à égal – qui hébergent collectivement l’information. « C’est un moyen concret de préserver la mémoire collective en mettant à son service des technologies avancées », commente Ana, l’une des membres de la coopérative.
Face au tournant conservateur des géants de la Tech dans le sillage de Trump, l’internet alternatif distribué et décentralisé commence à susciter un intérêt croissant : « On a la sensation qu’avec les mouvements collectifs de janvier, comme la campagne Vamonos Juntas ou HelloQuitteX, il y a une prise de conscience de l’importance d’avoir nos propres instances », commente SpiderAlex. Des milliers d’utilisateurs et d’utilisatrices ont quitté la plate-forme d’Elon Musk pour rejoindre Mastodon et le Fédiverse, des réseaux sociaux qui reposent sur la mise en réseau de plein de petits serveurs : des « instances » qui communiquent ensemble sans qu’aucune entité centrale ne contrôle l’ensemble. À l’inverse des grandes plates-formes qui ont tendance à centraliser les données, multiplier les instances permet de les faire circuler entre plusieurs machines. Ce qui rend les systèmes plus résilients face à la censure mais aussi aux pannes, car un réseau décentralisé continue de fonctionner même si une partie tombe en panne ou est inaccessible. Une manière d’esquisser un monde numérique plus participatif et horizontal.
Léna Rosada
Illustration : Fred Z
Paru dans La Brèche n° 12 (juin-septembre 2025)
- « Thousands of U.S. Government Web Pages Have Been Taken Down Since Friday », New York Times, 5 février 2025 ↩︎
- « When Online Content Disappears », Pew Research Center, mai 2024 ↩︎
Auto-hébergement : un geste politique et écologique ?
Internet est avant tout un réseau de matériel physique : des ordinateurs qui échangent des données, doivent être alimentés en énergie et reliés par des câbles. Des infrastructures invisibles dont on a tendance à oublier le coût écologique et énergétique. « De nombreux data centers utilisent de l’eau douce pour se refroidir. Les machines y sont remplacées bien avant d’être obsolètes. Les composants viennent de l’extractivisme dans le Sud global », énumère Fauno, de la coopérative technocritique Sutty. L’auto-hébergement, en reprenant la main sur une partie de cette infrastructure, permet de porter une attention aux ressources. « On aime dire qu’on remet de la matérialité dans le numérique : quand tu as tes disques durs chez toi et que tu vois qu’ils saturent, tu vas plus naturellement effacer tes données », explique Aleks, bénévole de YunoHost, un système qui facilite l’auto-hébergement.
Dans cet esprit « fait main », les militant·es de l’internet alternatif défendent l’usage de matériel réutilisé : « des ordinosaures » de seconde main ou des technologies peu gourmandes. Par exemple, dans son fanzine Comment monter un serveur cyberféministe à la maison, le collectif madrilène La Bekka recommande un Raspberry Pi, nano-ordinateur consommant 3 watts par heure. Elles repensent aussi les usages, en codant des outils capables de fonctionner avec une alimentation irrégulière, même en cas de coupure d’électricité.