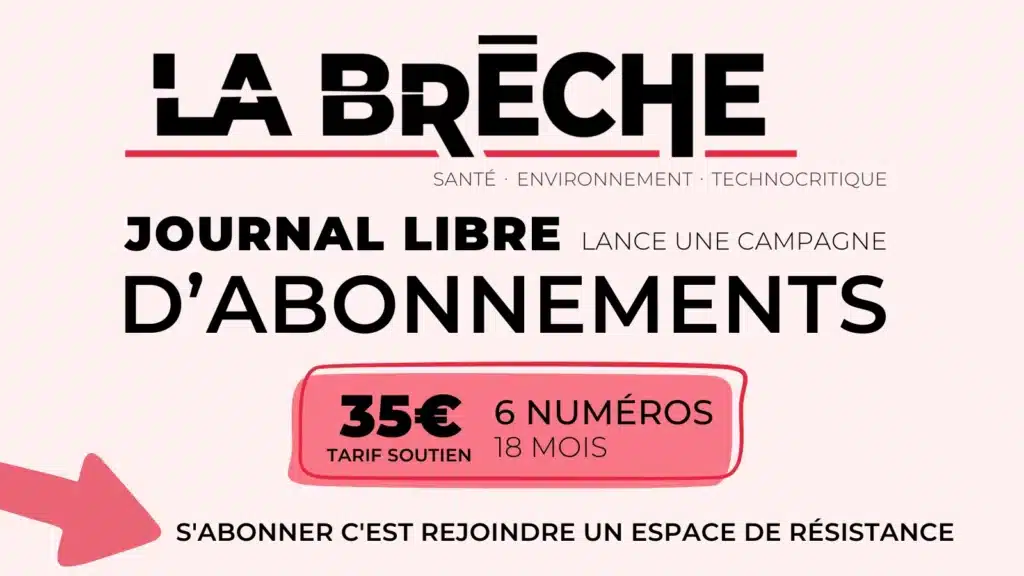Céréales : du poison dans les silos pour plus de spéculation
Les insectes sont les pires ennemis des coopératives céréalières, qui stockent leurs récoltes dans des silos en attendant que les cours leur soient favorables. Alors que la prolifération des ravageurs est favorisée par les étés de plus en plus chauds, le recours aux insecticides s’intensifie pour exporter au meilleur prix.
Dans les sites de stockage des coopératives céréalières françaises, l’usage d’insecticides, de manière préventive et curative, augmente. Les infestations d’insectes, et notamment de charançons, de plus en plus fréquentes, sont favorisées par des étés plus chauds qui compliquent le refroidissement du grain, à moins de ventiler davantage. Mais surtout, les coopératives qui exportent sont de plus en plus nombreuses, poussées par les fonds d’investissement qui entrent au capital, attirés par les profits possibles grâce à la spéculation. Ces structures sont soumises aux « exigences du marché », selon Pierre Duclos, ancien directeur des activités trading d’InVivo (union de 185 coopératives agricoles) et désormais consultant en trading de céréales. Parmi ces exigences, « certains clients demandent qu’il n’y ait pas de traces d’insectes dans les céréales. S’ils en trouvent, ils peuvent refuser la cargaison », faisant perdre ainsi « beaucoup d’argent » aux coopératives. Le traitement insecticide est alors la seule option.
La chasse aux traces d’insectes… mais pas aux résidus d’insecticides
Selon un rapport de l’association Terres de Liens, paru en février 2025, 43 % des terres agricoles françaises sont aujourd’hui destinées à l’exportation. Sur les 250 000 ha de blé dur cultivés en France chaque année, deux tiers sont vendus à l’export. « Aujourd’hui, les coopératives françaises ont à leur tête des financiers qui jouent sur la spéculation. Ce qui compte pour eux, c’est optimiser les coûts et surtout les gains », déplore Serge Le Quéau, membre du Collectif de soutien aux victimes des pesticides du Grand Ouest. « La volatilité des cours des matières premières et la concurrence étrangère leur imposent d’aller beaucoup plus vite et plus loin dans leur quête de compétitivité et de création de valeur », confirme un rapport Xerfi de 2024 sur « les défis majeurs des coopératives agricoles à l’horizon 2025 ». En 2024, les coopératives françaises ont malgré tout généré 104 milliards d’euros de chiffre d’affaires (filiales comprises), soit 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français, dans un contexte agricole pourtant morose. Pour profiter au mieux des fluctuations du marché et revendre au moment où les cours sont au plus haut, les coopératives doivent donc pouvoir stocker les céréales… En évitant les insectes.
« Permettre une commercialisation des grains au meilleur moment et au meilleur prix »
Fiche produit du K-Obiol, un insecticide
« 2024, c’était une année à charançons », soupire Hervé Philippe, ancien salarié d’une coopérative agricole bretonne et délégué syndical. À la fin de l’été dernier, ces petits coléoptères, considérés comme ravageurs pour les céréales, ont semé la panique dans les silos des coopératives françaises. En Bretagne, Eureden, qui a réuni Triskalia et le groupe d’Aucy en 2020, a sorti les grands moyens pour se débarrasser des insectes. En août 2024, la coopérative a reçu sur son site de stockage de céréales de Plouisy (Côtes-d’Armor) une livraison de 3 000 litres de K-Obiol UL V6, un insecticide à base de deltaméthrine, aux propriétés neurotoxiques, et de butoxyde de pipéronyle, un perturbateur endocrinien probable. Une quantité importante qui a inquiété les salariés du site. Ils ont donné l’alerte avec l’appui du Collectif de soutien aux victimes des pesticides du Grand Ouest.
« Aucune obligation de déclarer un traitement insecticide »
Francis Fleurat-Lessard, ancien chargé de recherches à l’Inrae
« 3 000 litres de K-Obiol, c’est énorme, s’agace Michel Besnard, président du collectif. C’est un produit autorisé, mais il est dangereux. C’est sans doute plus intéressant pour les coopératives d’utiliser des insecticides que de ventiler. » Plusieurs salariés ont noté que les ventilations des silos, censées permettre de faire descendre progressivement la température des grains après leur récolte, n’ont pas forcément toujours fonctionné pendant le stockage. « Avec la crise énergétique, les prix de l’électricité ont triplé… Je pense qu’ils ont voulu tirer là-dessus », confirme Hervé Philippe. Mais le grain, pas assez refroidi, a permis la prolifération des charançons, qui ont besoin de chaleur et d’humidité pour se développer. Contactée, Eureden confirme avoir « acheté du K-Obiol afin de traiter des lots de céréales, destinés à l’alimentation animale, qui étaient infestés par des charançons. Le volume n’était dédié qu’en partie au site de Plouisy ». La coopérative assure ne pas traiter de façon systématique, mais reconnaît être soumise « aux aléas climatiques et à notre environnement qui, parfois, peuvent conduire à des développements d’insectes. Dans ce cas, un traitement adapté est nécessaire, dans le plus strict respect de la réglementation ». À savoir, 8,4 litres d’insecticide pour 100 tonnes de céréales.
« La durée de vie de ces pesticides s’étend bien au-delà de la période de stockage »
Sur la fiche produit du K-Obiol, les fabricants affirment : « un traitement insecticide efficace sur toute la durée du stockage est donc de première nécessité pour permettre une commercialisation des grains au meilleur moment et au meilleur prix. » Le document met également en avant un « taux de résidus très faible dans les produits de transformation ». Mais, « la durée de vie de ces pesticides s’étend bien au-delà de la période de stockage en silo et, un jour, on retrouve leurs traces dans nos assiettes, dans les aliments à base de céréales », explique Francis Fleurat-Lessard, ancien chargé de recherches à l’Inrae et expert en gestion qualité sanitaire des produits alimentaires secs des industries agro-alimentaires, dans son ouvrage Résidus de pesticides dans les céréales alimentaires1. Lors de ses recherches sur le blé, il a trouvé des résidus de deltaméthrine, qui fait partie de la famille des pyréthrinoïdes (connue pour ses propriétés neurotoxiques), et de butoxyde de pipéronyle, un perturbateur endocrinien probable, utilisé comme adjuvant dans le K-Obiol, dans les grains traités. « L’association d’un perturbateur endocrinien (probable) aux insecticides pyréthrinoïdes (neurotoxiques) est questionnable au moins pour les aliments à base de céréales destinés aux enfants et aux adolescents qui sont encore en croissance et qui consomment pratiquement tous les jours des aliments à base de céréales susceptibles de contenir des résidus de pesticides de cette classe des pyréthrinoïdes associés au perturbateur endocrinien supposé », détaillait-il encore dans un article publié en 20212.
Francis Fleurat-Lessard précise aussi : « Il n’y a aucune obligation pour le stockeur de déclarer s’il a effectué ou non un traitement insecticide quand il met sa céréale sur le marché. » Une opacité qui a poussé en mars 2025 l’ONG Pesticides Action Network Europe à demander à l’Union Européenne de retirer immédiatement du marché la deltaméthrine, suite à la publication d’une étude qui a montré que l’exposition de souris enceintes à une dose 12 fois inférieure à la limite autorisée de la molécule provoque des dommages au cerveau des bébés. L’ONG signale aussi que la deltaméthrine « n’a pas été réévaluée depuis sa dernière autorisation il y a 23 ans ». Le Collectif de soutien aux victimes des pesticides du Grand Ouest a été auditionné le 7 avril par le Parlement européen sur le sujet. Ils ont dénoncé « des défaillances graves dans l’application des normes européennes sur les pesticides » dans les coopératives françaises et réclamé « d’intensifier les inspections ». Pour l’heure, les coopératives ont peu intérêt à se passer de la précieuse molécule. Pour preuve, Eureden a engrangé 3,8 milliards d’euros en 2024, dont la moitié provenait de son activité liée à l’agriculture.